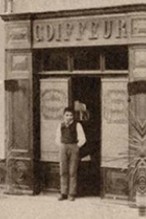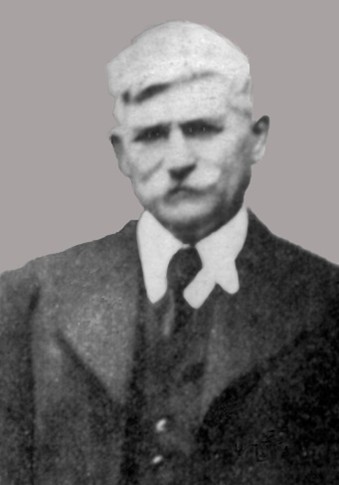Le peintre Gustave Riquet
Gustave RIQUET naît à Nîmes le 26 juin 1866 de père négociant. Il étudie la peinture, notamment dans l’atelier du peintre lillois Carolus-Duran.
Le 25 juin 1879, son oncle maternel Gustave LARMET de Nîmes épouse Augustine GUICHARD, fille de la famille protestante GUICHARD aubergiste à Mens. Gustave RIQUET devient le parrain des quatre enfants qu’a le couple.
Il séjourne fréquemment à Mens, en raison de ces liens familiaux.
Lors du baptême du premier enfant, le 6 août 1883, Gustave RIQUET est qualifié de peintre décorateur dans le registre des baptêmes de l’Église Réformée de Mens.
A ce titre, en 1896, Jacques ARNAUD, propriétaire du café des Arts lui confie la décoration de son établissement. Pour la somme de huit cents francs, Gustave RIQUET réalise un ensemble de remarquables peintures murales consacrées aux paysages du Trièves (le Mont Aiguille vu d’Amillières, l’Obiou et la route de Clelles, la ferme de la Chapelle et le Ménil, la ferme du Thau), de la Matheysine (le pont de Cognet, le lac de Petichet), et des vues de Mens : vue générale avec atmosphère à la Corot, et vue de la place de la Halle. Quant au plafond, il est orné de chérubins joufflus symbolisant les vendanges et la moisson.
Extrait de « l’Album de Mens et du Trièves (1870 – 1939) de Pierre BETHOUX concernant les peintures de Gustave RIQUET :
– Dans la notice qui précède le catalogue des œuvres de Gustave RIQUET exposées à Amiens en 1930, Alain DUBOIS, secrétaire de l’exposition, parle des leçons que l’artiste a recueillies auprès de la nature :
« M.RIQUET l’a contemplée avec amour, notant les changements qui se produisent dans les phénomènes lumineux et qui dépendent de la saison, de l’heure et du temps, observant toutes les merveilles dont elle se pare, les voiles légers dont elle se couvre, les frémissements qui l’agitent et les vibrations qui l’animent.
Dans ses œuvres, huiles ou aquarelles, nous trouvons cette interprétation, ces surprises, cette sorte d’inspiration particulière à ceux qui sont charmés par ce qu’ils voient et qui savent fixer l’essentiel d’un éphémère spectacle. Elles se distinguent, malgré une grande variété d’impressions, de pays, de climats, par la même franchise d’accent, la même décision et, car il est impossible de tout dire et de tout analyser, par la même volonté de dégager les traits caractéristiques, de perpétuer la sensation, l’émotion de l’heure et du lieu. L’on y reconnaît clairement la main d’un peintre qui possède trop son métier pour hésiter ou tâtonner, et qui pénètre assez à fond ses « motifs » pour en retenir les éléments qui les rendent intéressants. »
– Ces lignes si pénétrantes s’appliquent également aux compositions du Café des Arts. Situé esthétiquement entre la période lugubre des « assommoirs » et celle des débits de boissons anonymes du XX è siècle, poème à la nature et aux travaux de la campagne, le Café des Arts de Mens figure grâce à Gustave RIQUET parmi les chefs d’œuvre du genre.
Lorsqu’il séjourne dans le Trièves, Jean Giono évoque cet établissement avec beaucoup d’attachement. (Pierre BETHOUX)
En 1897, Gustave RIQUET est nommé professeur de peinture et de composition décorative à l’Ecole des BEAUX-Arts d’Amiens. C’est ainsi qu’il devient amiénois d’adoption, et le reste jusqu’à son décès, le 27 juillet 1938.
Il devient membre de la société des Artistes français en 1908. Il est aussi officier de l’Instruction publique.
Son œuvre, à Amiens et dans sa région, est importante : tableaux de chevalet, illustrations et peintures monumentales. Il décore des fresques d’églises (Sacré-Coeur d’Amiens, églises de la Somme), réalise des compositions décoratives pour des salons, mairie et salle des fêtes. Deux de ses huiles « Portrait de femme au théâtre » et « La Fosse à lait » sont conservées au musée d’Amiens.
Il est aussi auteur d’œuvres variées, portraits et paysages, vues de monuments (la Tour Magne à Nîmes, le pont des Saints-Pères à Paris), scènes de genre (Fête de village en Provence, Marché aux poissons à Marseille) et compositions allégoriques.
Quatre générations d’ARNAUD
Un enfant en culotte courte parmi les angelots du plafond du café, un adolescent élégant devant la porte du salon de coiffure, un vieil homme au visage très doux, ce sont trois visages d’Édouard, le troisième Arnaud du café des Arts.
Avant lui, il y a eu Jacques II, son oncle, coiffeur et cafetier, car l’établissement a longtemps associé les deux activités. C’est lui qui a fait représenter son neveu au plafond par Gustave Riquet. C’est lui qui l’a formé au métier de coiffeur puis lui a confié les rennes du café.
Encore avant il y a son grand-père, Jacques Ier qui, au début du Second Empire, à une époque où il n’y a ni sécurité sociale ni caisses de retraite, fait de son café le rendez-vous des sociétaires d’une association d’assistance mutuelle des Arts et Métiers. Napoléon III, malin, les a autorisées car elles allient l’entraide entre artisans et la possibilité pour le pouvoir de les contrôler, ces sociétés étant souvent organisées par des républicains convaincus. C’est le cas pour les Arnaud.
Avec Claude, le fils cadet d’Édouard qui lui succède, cela fait donc quatre générations d’Arnaud dans ce bistrot.
Édouard et ses fils
Revenons à Édouard, troisième génération. Quand est déclarée la première guerre, dite Grande, il a 31 ans. Mobilisé en août comme tous les hommes jeunes et valides de Mens, il est fait prisonnier dès septembre 1914. Il passe les quatre ans de guerre en captivité en Allemagne.
En novembre 1941, il est conseiller municipal quand le maire, Paul Brachet, meurt. On est sous le régime de Vichy, les maires sont nommés par le préfet dans les grandes communes, ils sont élus mais étroitement contrôlés dans les petites. Devenu maire, il ne cède rien à Vichy, ni à l’occupant italien puis allemand. Il protège les jeunes réfractaires au STO, leur fournit des tickets de rationnement, fournit des faux-papiers aux Juifs, le plus souvent étrangers, qui sont abrités dans la commune. Quant à ses deux fils, Édouard et Claude, ils se joignent au groupe de jeunes Mensois qui se préparent à l’assaut final. Le 29 juin 1944, ils sont tous deux montés à Baret, sur les flancs du Châtel, où se forme le maquis de Mens.
Arrestation et déportation
Le 3 juillet 1944, un détachement de l’armée allemande, accompagné d’une voiture de la gestapo où se trouve déjà un prisonnier, Francisque Forest, arrêté à Lalley, investit Mens. Ils arrêtent Édouard Arnaud, dynamitent le café de Paris qui sert de lieu de rendez-vous aux jeunes de Mens, incendient la scierie Gras appartenant à l’un des jeunes maquisards, puis fusillent Francisque Forest au Pont de l’Arène.
Claude, le plus jeune des fils Arnaud, quitte le maquis pour aider sa mère au café tandis que l’aîné, Édouard, se trouve au Pas de l’Aiguille lors de son investissement par l’armée allemande. Rescapé, il poursuit le combat en rejoignant les Forces françaises libres.
Édouard Arnaud est déporté. Il meurt d’épuisement à Neuengamme le 29 janvier 1945.
Claude est le dernier des Arnaud à tenir le café des Arts jusqu’en 1987.
Restauration
Depuis 1987, c’est Evelyne Valla qui préside aux destinées du café des Arts… qui est maintenant aussi un restaurant.